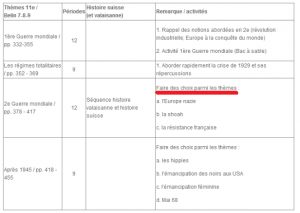Les sciences cognitives ont depuis longtemps démontré que tous les choix que nous faisons sont largement tributaires de ce que nous possédons en mémoire. Nos connaissances et expériences dictent la manière dont nous pensons et nous agissons.
Reste à savoir maintenant comment le cerveau fonctionne, de quelle manière il organise et réorganise le contenu sa mémoire lors de ses apprentissages. Comment il traite les données des situations vécues et y donne réponse. Dans un ouvrage récent[1], les cognitivistes Hofstadter et Sandler avancent une réponse plutôt originale : la clé de voûte de tout l’édifice de la pensée résiderait dans les analogies.
Notre cerveau n’aurait de cesse d’élaborer continuellement des analogies entre les situations qu’il rencontre et ce qu’il connait déjà afin d’interpréter ce qui est nouveau et inconnu dans des termes anciens et connus. En clair, toute forme de pensée ne serait rien d’autre que le fruit d’analogies avec les contenus de notre mémoire à long terme.
Comprendre un énoncé dans une perspective analogique
Lorsque des élèves sont confrontés à de nouveaux contenus, ils font inconsciemment des analogies avec des évènements ou avec des notions simples et familières pour eux. C’est par le biais de ces analogies qu’ils pourront acquérir de nouveaux concepts.[2]
Chaque notion nouvelle est comparée à ce qui se situe dans la mémoire à long terme. C’est comme cela que l’élève les appréhende, qu’il construit une représentation de ce qu’il rencontre. Il va systématiquement chercher quelque chose de plus ou moins similaire dans sa mémoire afin de pouvoir interpréter la nouvelle donnée. Par exemple, imaginons un enfant qui connait la soustraction mais à qui on n’a pas encore enseigné les nombres relatifs. S’il se retrouve devant l’intitulé 3 – 8 = ?, il ira chercher une similitude dans la réserve de sa mémoire et réalisera une analogie avec la résolution de la soustraction. Il prendra donc le plus grand des deux nombres (8) et lui soustraira le plus petit (3) pour arriver au résultat de 5.
De ce mode de fonctionnement découle l’idée qu’une mémoire à long terme bien fournie permet d’appréhender plus facilement de nouvelles notions. Plus la mémoire est riche en concepts et catégories sur le domaine en question et plus elle permet d’adopter de points de vue différents, de comprendre les différents éléments constituant la nouveauté à appréhender. Et donc d’en atteindre l’essence. Bien entendu, d’autres concepts qui ne sont pas directement en lien avec le domaine en question entrent également en jeu. Il suffit d’approfondir un peu l’exemple précédent pour s’en rendre compte. Avant de pouvoir résoudre 3 – 8, il faut entre autres, outre des connaissances sur la soustraction des relatifs, savoir lire, écrire, et comprendre les quantités ainsi représentées. Quoi qu’il en soit, la qualité et la quantité des connaissances déjà en possession de l’élève détermineront sa capacité à en acquérir de nouvelles et à se les approprier.
Apprendre par l’analogie
Lorsque nous rencontrons des situations nouvelles, le cerveau ne se contente pas d’aller puiser dans sa mémoire à long terme. La nouveauté va, elle aussi, agir sur le contenu de notre mémoire, bonifier ce qui s’y trouve, l’étendre et/ou le réorganiser. Quoi que nous fassions, nous apprenons toujours quelque chose de ce que nous vivons. Si chaque idée nouvelle dépend des idées antérieures, elle donne, dans le même temps, un regard nouveau et plus profond sur celles-ci.
Chaque nouvel apprentissage se fait par analogie. Les concepts que nous avons dans notre mémoire s’étendent, se raffinent sans cesse par analogie. Par exemple, la première fois que vous avez vu une tasse dans votre vie et qu’on vous a dit qu’il s’agissait d’une tasse, alors vous avez assimilé au concept tasse ce que vous avez vu. Peut-être était-elle bleue. Avec une anse. Et donc pour vous, une tasse était nécessairement bleue avec une anse. A la longue, vous avez été confronté à de multiples autres tasses, des grandes, des petites, de toutes les couleurs etc. Dans votre esprit, la « tasse » a donc évolué en prenant en considération l’ensemble de ces variations si bien qu’aujourd’hui, quelle que soit la tasse qu’on vous présente, vous savez que c’en est une. Votre cerveau n’a eu de cesse que de faire des analogies entre les différentes tasses pour en abstraire un prototype/stéréotype autour duquel gravitent toutes les autres.
Ce raffinement de ce qu’est une tasse dans votre esprit a été jusqu’au point où vous comprenez aujourd’hui ce que signifie l’expression boire la tasse. Lorsque vous entendez cette expression, vous n’imaginez pas quelqu’un dégustant un breuvage dans une tasse. Ce qui démontre à quel point l’évolution de ce que vous comprenez sous le concept de tasse peut aller loin dans le raffinement.
Partir des représentations préalables des élèves
Cette manière de fonctionner doit faire prendre conscience que partir des représentations préalables des élèves n’est pas un souhait mais un constat. Qu’on le veuille ou non, l’élève interprète nécessairement à partir de ce qu’il connait. Il n’est donc pas pertinent de rentrer dans une nouvelle matière sans en tenir compte. Si la nouveauté est trop éloignée de ce qu’il sait, l’élève n’accrochera pas le bon wagon dès le départ et risque fort de se retrouver perdu ou de produire une interprétation qui soit totalement erronée. Faire un rappel au sujet des prérequis nécessaires en guise d’introduction semble donc une bonne entrée en matière.
Il est tout aussi possible de mettre sur pied un dispositif visant à prendre connaissance de ce que savent déjà les élèves et d’ainsi adapter l’entrée en matière du dispositif consacré au nouvel objet d’apprentissage. Il faut toutefois veiller à bien gérer son temps afin de ne pas se retrouver à devoir meubler une fin d’heure entière en attendant de pouvoir adapter ses documents d’ici le cours suivant.
Enfin, une dernière solution consiste à proposer un point d’entrée fixe dont on est à peu près sûr que l’ensemble des élèves peuvent saisir et de les faire partir de là. C’est le principe même qui prévaut dans la méthode de mathématiques utilisée à Singapour et qui donne de si bons résultats dans les tests internationaux : l’élève rentre dans la nouvelle notion par des notions concrètes qui vont petit à petit s’effacer pour laisser leur place aux abstractions nécessaires. Par exemple, si l’objectif est d’enseigner l’addition à des élèves qui savent déjà compter, alors, l’enseignant va représenter sur une première ligne un ensemble de 4 oranges et en mettre un autre de 3 oranges sur une deuxième ligne. L’élève va donc pouvoir compter le nombre d’oranges total au lieu de commencer directement par un 4 + 3 = 7
L’apprentissage par analogie démontre la faiblesse des approches axées sur la découverte…
Aussi en vogue que puissent être dans les milieux académiques consacrés à la formation les approches dites « centrées sur l’élève » elles n’obtiennent généralement dans les mesures effectuées, que des résultats assez faibles voir médiocres.
Ces résultats se comprennent, à mon avis, aisément si on adopte la grille de lecture de la pensée analogique. Si le cerveau fonctionne effectivement de la sorte, alors l’aspect chronophage de la découverte par soi-même parait radicalement rédhibitoire. Car même si l’élève parvient à saisir l’essence de la nouveauté ainsi enseignée, il ne sera confronté qu’à un nombre plus réduit de cas partageant cette même essence. En conséquence, sa capacité à mettre ceux-ci en lien les uns avec les autres, à étendre la portée des analogies possibles entre ceux-ci sera plus limitée qu’avec un enseignement plus directif. Le concept nouveau ne peut donc pas se développer de manière optimale. Et l’élève se retrouve ainsi avec une vision, éventuellement correcte, mais étriquée de ce qu’est réellement la nouveauté ainsi enseignée. Il est donc faux de prétendre que le fait de chercher par soi-même induit une plus grande profondeur dans la compréhension.
Bien entendu, tout cela dépend largement du temps consacré à la découverte et ne prête pas trop à conséquence dès lors que les élèves ne sont pas laissés trop longtemps en situation de découverte pure.
… et consacre les principes de l’enseignement explicite
Adopter la grille d’analyse de la pensée par analogie parait en outre également justifier l’écrasante supériorité démontrée par l’enseignement explicite dans la totalité des tests empiriques sur le terrain.[3] En effet, un enseignant explicite fournit de nombreux exemples à ses élèves (phase de modelage). Des exemples qui mettent à nu l’essence du concept et en démontre l’étendue tout comme les limites. Des exemples qui ont de plus la vertu d’être correctement résolus et ainsi n’induisent ainsi pas de mauvaise compréhension.
Comme l’enseignant passe également un temps conséquent à vérifier ce que les élèves ont compris en travaillant de concert avec eux toute une série d’exemples supplémentaires, il s’assure que ceux-ci se façonnent un stéréotype/prototype correct et que les limites du concept sont bien saisies avant qu’ils ne se lancent dans une phase de travail autonome.
Au final, les élèves se retrouvent donc à façonner un concept de manière plus facile et disposent d’un corpus de présentation riche, permettant de multiples analogies et conduisant ainsi à un raffinement plus poussé de la connaissance récemment acquise.
Si l’hypothèse de l’analogie s’avère exacte, alors il faut en déduire que l’enseignement explicite semble être la manière de procéder la plus en phase avec le fonctionnement du cerveau humain. Comme ce dernier, cette approche va s’obstiner à créer un stéréotype/prototype du concept, en étendre la portée au maximum et même en démontrer les limites par une multitude de situations offertes à la compréhension des élèves.
Une telle symbiose ne peut que permettre au cerveau d’exploiter en plein ses capacités. Ce qui d’ailleurs se démontre par les tests réalisés et donne, à mon sens, un crédit supplémentaire à l’hypothèse de la pensée analogique tout comme à l’enseignement explicite…
Pour LesObservateurs et Contre-Réforme, Stevan Miljevic, le 14 décembre 2016
[1] Douglas Hofstadter, Emmanuel Sander « L’analogie, coeur de la pensée », Odile Jacob, Paris 2013
[2] Ibid. p.469
[3] Pour n’en citer que quelques uns, le Visible Learning de John Hattie, plus grande méga analyse réalisée à ce jour, tout comme le projet Follow Through ou même le dernier test PISA sont sans équivoque à ce sujet. Pour une liste plus complète, je vous invite à consulter « Échec scolaire et réforme éducative: quand les solutions proposées deviennent la source du problème » ou « Comment enseigne-t-on dans les écoles efficaces? Efficacité des écoles et des réformes » des professeurs Gauthier, Bissonnette et Richard