Ndlr. Déjà dans les années 1990 (en 1983), nous avons traduit et publié un ouvrage de Thomas Sowell, L’Amérique des ethnies, aux Editions de l’Age d’Homme, Lausanne-Paris, dans la Collection Cheminement des sciences de l’homme dirigée par Uli Windisch. Thomas Sowell décrivait et analysait au moyen d’enquêtes, notamment économiques, chiffrées et très fouillées, la situation réelle des Noirs, contrairement aux représentations idéologiques imposées par le politiquement correct du gauchisme. Il faisait face à une telle hostilité haineuse de la gauche qu’il venait souvent le soir à son bureau. Je me réjouis qu’il soit aujourd’hui considéré comme : “Un des penseurs les plus respectés aux USA”.
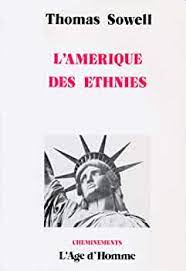
Économiste de formation, historien autodidacte, sociologue par son analyse des structures culturelles, psychologue par son décryptage des ressorts mentaux de l’intelligentsia et philosophe par la profondeur de sa pensée, Thomas Sowell est l’auteur d’une œuvre immense et iconoclaste. Né en 1930 dans une famille afro-américaine en Caroline du Nord, il perd rapidement ses deux parents, grandit à Harlem dans la précarité et le chaos domestique, quitte l’école à 17 ans en raison de difficultés financières et s’engage dans les Marines. À sa sortie, il décide de reprendre les études : il intègre Harvard (dont il sort avec la meilleure note possible), entre en master à Columbia et obtient un doctorat d’économie à l’université de Chicago, sous la direction de George Stigler, le futur “Prix Nobel” d’économie. Le voilà propulsé vers une carrière universitaire brillante, au cours de laquelle il publiera plus de 45 ouvrages et deviendra l’un des penseurs les plus respectés des États-Unis.
Un des penseurs les plus respectés des États-Unis
Son enfance lui permet d’observer les facteurs conduisant certains Afro-Américains à l’échec éducatif ou à la délinquance, et façonne chez lui une méfiance envers les grilles de lecture victimaires. Beaucoup de jeunes Noirs, note Sowell, sont avant tout victimes non pas des Blancs mais des dynamiques endogènes à leurs communautés (prévalence des familles monoparentales, dévalorisation de la réussite scolaire, sous-cultures antisociales…). Or, en imputant les difficultés des minorités uniquement au racisme de la société américaine, certains progressistes enferment les minorités dans un rôle de victimes passives, impuissantes à agir sur le cours de leur destin, condamnées au ressentiment. Implicitement, ces discours envoient un message aux communautés en difficulté : c’est aux autres de fournir des efforts, pas à vous. Sowell rappelle que dans la société britannique du début du XVIIIe siècle, les Écossais occupaient une position relativement périphérique. Plutôt que de cultiver leur rancœur à l’égard de la majorité, David Hume leur a enjoint d’apprendre l’anglais, de se former à la science et de développer leurs compétences dans les arts. Les Écossais ont alors connu une ascension impressionnante, dépassant les Anglais dans de nombreux domaines et contribuant significativement au débat intellectuel (Adam Smith, James Watt, Walter Scott et Hume lui-même étaient par exemple tous écossais). Si les défenseurs de la justice sociale étaient mus par le désir d’améliorer les conditions de vie des minorités plutôt que par celui de se donner le beau rôle, c’est ce modèle qu’ils privilégieraient.
Tout au long de son œuvre, Sowell revient régulièrement sur le thème des disparités entre groupes humains. En s’appuyant sur une foule d’exemples historiques, tirés de pays variés observés sur plusieurs siècles, il montre qu’aucune société, à aucune époque, n’a connu une répartition proportionnelle des différents groupes ethniques, culturels ou religieux dans les diverses sphères de la vie sociale. Ces écarts tiennent en général à une multitude de facteurs : différences d’histoire, de culture, de normes familiales, de capital humain transmis, d’aptitudes linguistiques ou de structures d’incitation. Pourtant, observe-t-il avec ironie, dans le climat intellectuel contemporain, toute déviation par rapport à une représentation strictement égalitaire est perçue comme une preuve définitive du racisme de la société. Cette confusion entre inégalités de résultats et injustice structurelle constitue, selon Sowell, l’un des grands sophismes de notre temps. De la même manière que les cancers existent mais qu’on ne peut pas automatiquement les accuser d’être responsables de tous les décès, le racisme existe mais on ne peut pas automatiquement lui imputer la responsabilité de toutes les disparités statistiques.
Sur le même modèle, Sowell déconstruit l’idée que les asymétries entre hommes et femmes seraient nécessairement le fruit du patriarcat ou de discriminations misogynes sur le marché du travail. En analysant minutieusement les données empiriques, il démontre que les écarts bruts observés sont souvent le résultat de choix féminins (en matière d’orientation professionnelle, de temps de travail ou de priorités de vie), qu’il n’est pas nécessairement souhaitable de déconstruire s’ils relèvent de l’exercice du libre arbitre. « Beaucoup de ce que l’on désigne comme des “problèmes sociaux”, s’amuse-t-il, ne sont souvent que des divergences entre les constructions théoriques des intellectuels et la réalité concrète. Quand la réalité ne concorde pas avec sa théorie, l’intellectuel conclut souvent qu’il faut modifier la réalité plutôt que sa théorie. » Aujourd’hui, l’une des formes les plus tenaces de cette volonté de réagencement social réside dans les politiques cherchant à imposer une parité parfaite entre hommes et femmes dans différents secteurs de la vie publique. Face à ces projets d’ingénierie sociale, Sowell cite souvent Adam Smith, qui notait que de nombreux intellectuels « épris de la beauté de leur vision de la société idéale » en viennent à considérer leurs concitoyens comme une matière inerte à laquelle ils peuvent imprimer un mouvement « avec autant de facilité que la main dispose les pièces sur un échiquier ».
Mais contrairement aux pièces d’échecs, les individus disposent de préférences et d’aspirations, incompatibles avec les grands projets des ingénieurs sociaux. C’est d’ailleurs en raison de cette incompatibilité que l’ingénierie sociale tend inévitablement à verser dans la coercition et l’autoritarisme.
Plus largement, l’œuvre de Sowell est traversée par un scepticisme radical à l’égard de ceux qui, parmi l’élite, se considèrent comme investis de la mission de régir le destin de leurs concitoyens, persuadés de savoir mieux que l’homme ordinaire ce qui est bon pour lui et de pouvoir préempter ses décisions. Ce scepticisme n’est pas motivé par une quelconque forme de populisme, mais par une analyse rationnelle des mécanismes permettant l’émergence d’un ordre social stable et harmonieux. Premièrement, en disciple de Hayek, Sowell insiste sur un point fondamental : la connaissance est dispersée dans la société, enracinée dans des situations locales ; les théoriciens, même les plus brillants, ne peuvent y avoir pleinement accès. C’est pourquoi les décisions politiques ou les prescriptions de l’intelligentsia (produites à partir d’un savoir partiel, souvent abstrait) sont fréquemment moins soutenables que les arbitrages spontanés émergeant de l’intelligence collective mobilisée via des millions de décisions individuelles décentralisées. « Puisque personne ne détient ne serait-ce que 1 % de toute la connaissance présente dans une société, il est vital que les 99 % restants, dispersés en petites quantités presque négligeables à l’échelle individuelle, puissent être librement mobilisés par les individus au gré de l’échange et des arrangements spontanés. Voilà pourquoi le marché libre, la limitation du pouvoir des juges et la confiance dans les décisions enracinées dans l’expérience collective sont si précieux. »
Deuxièmement, Sowell constate (et son intuition est largement confirmée par les dernières décennies de travaux en sciences cognitives) que l’on se trompe bien davantage lorsqu’on ne subit pas soi-même les conséquences de ses erreurs. Or c’est précisément le cas des tiers (intellectuels, bureaucrates, experts…) qui prétendent décider pour l’individu à sa place (par exemple en imposant des interdictions, en subventionnant avec son argent ce qu’il devrait vouloir consommer, ou en façonnant ses préférences en le rééduquant). Non seulement ces tiers vivent souvent à l’abri des conséquences de ce qu’ils prônent, mais, en plus, ils sont jugés non pas selon l’efficacité de leur action mais selon leur degré d’adhésion au conformisme du moment. Peu importe que des politiques éducatives échouent, que des programmes sociaux engendrent dépendance et désintégration familiale, ou que de belles intentions écologiques détruisent des filières économiques, ce qui compte, c’est l’image vertueuse que ces idées renvoient de ceux qui les défendent. À l’inverse, lorsqu’un individu se trompe, il en subit directement les conséquences ; ainsi est-il incité à ne pas se tromper. « Il est difficile d’imaginer manière plus stupide ou plus dangereuse de prendre des décisions que de les confier à des personnes qui ne paient aucun prix lorsqu’elles se trompent », résume Sowell.
Troisièmement, lorsque les décisions sont laissées aux individus plutôt qu’imposées par le haut, l’erreur reste circonscrite à celui qui la commet et peut être corrigée rapidement et localement avant qu’elle ne contamine l’ensemble de la société, comme le ferait une politique publique mal conçue mais administrée uniformément. Comment expliquer qu’une partie de l’intelligentsia voie d’un mauvais œil les régimes d’incitations où ceux qui prennent de bonnes décisions sont récompensés ? « Ces systèmes, nous dit Sowell, suscitent des rancunes chez ceux qui sont convaincus que seuls l’aisance oratoire, l’engagement politique et l’ardeur morale devraient valoir distinction. » Piste intéressante pour expliquer l’anticapitalisme de l’élite universitaire…
la nature humaine
On ne peut conclure sans évoquer le thème qui irrigue chacun des ouvrages de Sowell et constitue pour lui le fondement implicite de toute réflexion politique, économique ou sociale : la nature humaine. Il distingue deux visions de l’homme : la vision candide ( « Il n’y a pas de perversité originelle dans le cœur humain ») et la vision tragique ( « La frontière entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme »). Ceux qui adoptent la vision tragique – Sowell en fait évidemment partie -cherchent à concevoir des institutions qui fonctionnent malgré les limites humaines, s’attachant à construire des systèmes d’incitations capables de canaliser ses penchants les plus nuisibles et de tirer parti de ses motivations ordinaires pour produire des effets collectifs bénéfiques. Ils savent que la vie en société implique des frictions, des tensions et des limitations (liées à l’imperfection de la nature humaine) et que ce n’est pas parce qu’un système produit des résultats imparfaits que le système en lui-même est imparfait. Le système est bon s’il limite la portée des erreurs et génère l’ordre et l’harmonie relative sans exiger l’infaillibilité de chacun de ses agents. À l’inverse, ceux qui adhèrent à la vision candide de la nature humaine croient qu’il est possible de construire un système produisant des résultats parfaits – et se montrent donc insatisfaits de tout système ne les produisant pas – ce qui explique leur soif de table rase. Par exemple, ce qui les frappe n’est pas la rareté relative du mal dans nos sociétés mais son existence même, perçue non comme une constante anthropologique mais comme une faillite collective (imputable à une institution ou à une classe sociale). De même, ce qu’ils cherchent à expliquer n’est pas la prospérité (envisagée comme l’état naturel des choses) mais la pauvreté, dont la persistance justifierait la condamnation de notre système économique. Ces personnes, écrit Sowell, « se demandent rarement pourquoi nos sociétés ne connaissent pas la pauvreté de l’Inde, l’oppression politique de la Corée du Nord, l’anarchie du Liberia, ou les massacres du Rwanda. Il ne leur vient donc pas à l’esprit que cela pourrait être lié aux valeurs, aux traditions et aux constructions sociales qu’ils s’acharnent à déconstruire ».
L’autre erreur des adeptes d’une vision naïve de la condition humaine, selon Sowell, est de percevoir chaque aspect insatisfaisant de la réalité sociale comme un dysfonctionnement appelant une solution, plutôt que comme le résultat d’un arbitrage entre contraintes inconciliables. Là où il faudrait voir des choix difficiles entre des biens en tension dans un monde aux ressources limitées, certains ne voient que des problèmes à résoudre avec de la volonté politique et un désir de justice sociale. C’est pourquoi ils se demandent “comment éliminer telle caractéristique déplaisante de la situation actuelle ?” plutôt que “que doit-on sacrifier pour atteindre telle amélioration, et cela en vaut-il la peine ?”. Pourtant, la bonne question ne devrait pas être de savoir si l’on est dans l’absolu favorable aux biens poursuivis par une politique publique (mettons : l’accès à la culture via le chèque culture, l’accès à la connaissance via la gratuité de l’université, le soutien à la société civile via les subventions aux associations, etc. ), mais de savoir si l’on préférerait que les ressources allouées à la poursuite de ces biens soient allouées à la poursuite d’autres biens (mettons : à la justice, à l’hôpital, à l’école, au pouvoir d’achat via des baisses d’impôts, etc.).
« La première chose que l’on apprend en économie, écrit Sowell, c’est que les ressources sont limitées. La première chose que l’on apprend en politique, c’est d’ignorer la première leçon de l’économie. » Malheureusement, le fait de voir des solutions plutôt que des arbitrages engendre un biais d’action. Or, comme le démontre Sowell, la plupart des solutions présumées ont un coût, créent de nouveaux problèmes ailleurs ( « La plupart des problèmes d’aujourd’hui sont les solutions d’hier », écrit-il), ou reviennent simplement à déplacer la charge sur des groupes moins visibles ou moins bruyants (admirateur de Bastiat, Sowell ne cesse de rappeler qu’il y a ce que l’on voit, mais aussi ce que l’on ne voit pas). Une fois que le législateur est intervenu, la nouvelle configuration n’est souvent qu’un arbitrage différent – et moins bon puisqu’il n’est pas le fruit de l’expérience ou de la coordination des acteurs concernés, mais d’une décision prise par des tiers peu au fait des réalités du terrain et peu exposés aux conséquences de leur décision. Thomas Sowell est l’un des plus grands intellectuels vivants, et il est malheureusement trop méconnu en France. Mais nous avons de la chance : son dernier essai, Illusions de la justice sociale, vient d’être traduit en français, aux éditions Carmin.
Dernier ouvrage paru de Samuel Fitoussi : Pourquoi les intellectuels se trompent, Éditions de l’Observatoire, 2025.
L’article Thomas Sowell, l’économiste incarné est apparu en premier sur Valeurs actuelles.
Extrait de: Source et auteur








Et vous, qu'en pensez vous ?