De livre en livre, le géographe Christophe Guilluy ne cesse de décrire la fracture entre les élites et le peuple. Métropolia et Périphéria (Flammarion), son nouvel opus, ne déroge pas à la règle mais est sans doute son essai le plus personnel. Guilluy y mêle fable orwellienne, satire et souvenirs autobiographiques pour mieux toucher du doigt la contestation existentielle initiée par les gens ordinaires.LE FIGARO. — Votre nouveau livre prend la forme d’une fable orwellienne. Vous y racontez la révolte et la victoire de Périphéria sur Métropolia. Cette victoire représente-t-elle le basculement culturel qui traverse l’occident ?CHRISTOPHE GUILLUY. — Oui, vous avez bien reconnu, c’est même je crois la description la plus réaliste possible du renversement culturel et politique de l’Occident qui est en cours. Une force tellurique, qui se nourrit depuis des décennies de la dépossession des classes moyennes et populaires par un modèle qui ne fait plus société – celui de Métropolia –, est en train de nous faire passer d’un monde à l’autre. Le centre de gravité culturel des sociétés occidentales est en passe de basculer du côté de la majorité ordinaire, du côté de Périphéria. Ce processus n’est d’ailleurs qu’un aboutissement puisque depuis vingt ans toutes les contestations sociales ou politiques sans exception ont émergé dans les périphéries et nulle part ailleurs.
— La victoire de Trump aux États-unis est-elle une conséquence de ce basculement ?— La majorité ordinaire américaine, celle des classes populaires et moyennes, vit à Périphéria. C’est elle qui a porté Trump à la Maison-blanche. Mais il est important de rappeler que, contrairement à ce qu’on imagine, Donald Trump n’a pas créé ce mouvement : il s’y est au contraire adapté. Notamment sur les conseils de JD Vance, il a intégré (ce qu’il n’avait pas fait en 2020), les nouvelles attentes, et surtout la réalité de ces catégories populaires qui ne ressemblent plus aux catégories populaires du siècle passé. Cette majorité ordinaire est – comme en France - largement désidéologisée (avec la fin du clivage droite/gauche) et autonomisée (c’est une conséquence de l’ostracisation culturelle dont elle est victime). Enfin, elle s’est recomposée démographiquement. En Occident, les classes populaires sont désormais multiethniques et multiconfessionnelles mais peuvent se rassembler sur la défense d’un mode de vie, des valeurs communes et une volonté, celle de vouloir continuer à « faire société » en refusant l’idée d’une société liquide, relative. C’est la compréhension de cette recomposition démographique au sein des milieux populaires qui a permis à Trump de capter près de la moitié du vote des Latinos – et une fraction du vote noir – sans lesquels il n’aurait pu l’emporter.
— À cet égard, qu’est-ce que vous ont inspiré le discours de JD Vance et les réactions qu’il a suscitées ?— Le plus significatif, ce sont évidemment les réactions outrées et le plus souvent surjouées du petit salon européen. Comment en est-on arrivé là ? Comment peut-on être aussi fragile ? Qu’est-ce qu’une société qui a peur des mots d’un conférencier ? Est-ce encore une société libre, qui tient debout ? Car ce sont bien des mots qui ont provoqué cette panique. Pourtant, JD Vance a-t-il interdit aux Européens de penser contre lui ? Non. De proposer un modèle alternatif, de converser ? Non. Mais, sur le fond, je crois que ce qui a choqué, c’est l’évocation d’un vieux concept démocratique avec lequel les Européens sont désormais très mal à l’aise : celui de l’existence d’une majorité ordinaire, et, pire, d’une majorité qui serait souveraine. En Europe, et spécifiquement en France, lorsqu’on évoque l’existence d’une majorité ordinaire, on vous répond que cela n’existe plus, que le pays ne serait constitué que de segments, de minorités, de morceaux de territoire, bref d’un conglomérat sans valeurs communes, bref, qu’il n’y aurait «plus de société », comme le disait Margaret Thatcher. Le paradoxe est d’entendre un Américain faire une leçon de souverainisme à des Européens qui ne parlent plus désormais que le langage du marketing, celui du panel, du morcellement infini, des gens pour qui la société, le bien commun ont disparu au profit du marché. En fait, la peur panique de la majorité perceptible à chaque fois que Périphéria gronde (référendum de 2005, « gilets jaunes », Brexit, vote populiste…) n’a cessé de se renforcer. Vous remarquerez que, déjà enfermées dans leurs citadelles métropoles, les classes supérieures « progressistes » demandent maintenant l’installation de la ZFE pour en finir définitivement avec la moindre cohabitation avec les classes populaires. Vous verrez, dans quelque temps, Paris, Bordeaux, Lyon, New York ou la Californie demanderont leur indépendance !
— JD Vance est un enfant des classes populaires. Son accession à la vice-présidence des États-unis est-elle un symbole ?— D’abord, je voudrais rappeler un point : l’origine populaire ne dit rien de la hauteur ou de la bassesse de vue. La plupart des gens d’en bas qui «montent» se fondent parfaitement dans le décor, ce qui fait d’ailleurs perdurer le modèle souvent pour le pire. Ce qui me plaît chez Vance, c’est la clarté de sa pensée. Le monde des clercs parlerait ici de simplisme, évidemment. D’ailleurs, je rappelle dans le livre la définition que les gens ordinaires me donnaient de l’intelligence : «Est intelligent celui qui comprend les choses. » Cette définition permet d’opérer un distinguo assez radical entre nos gouvernants et un Vance, vous ne trouvez pas ? Et puis, j’apprécie beaucoup les gens qui sont capables de penser contre leur propre camp. Or c’est le cas de Vance, qui était démocrate, comme beaucoup de Blancs de la « working class », il avait d’ailleurs soutenu Hillary Clinton et critiqué violemment Trump. Il avait donc reçu immédiatement la bénédiction du « Vatican », du New York Times et de sa succursale Netflix, qui a acheté les droits de son livre. Et puis, catastrophe, Vance opère avec sincérité un revirement radical en admettant qu’il s’était trompé et en soutenant Trump parce qu’il s’engageait notamment à stopper les délocalisations pour réindustrialiser. Depuis, JD Vance est cloué au pilori par ceux qui le plébiscitaient hier, alors que, fondamentalement, il n’a pas changé sur le fond. Démocrate ou républicain, la sincérité de son engagement pour la défense des gens ordinaires est la même.— Au-delà de Trump ou de Vance, assiste-t-on au renversement de la table par les classes moyennes et populaires ?— Ce retour des classes populaires dépasse Trump, Vance et même ce qu’on appelle le populisme. Ce retour de la majorité est non seulement un retour à la démocratie, mais aussi celui de la société, de ses valeurs, mais aussi de la civilisation. C’est un aspect qu’on relève peu souvent, mais on oublie que ce sont d’abord les classes populaires, la majorité, qui fait vivre ou non une société. Celles-ci ne sont pas seulement « les premières de corvées », ce sont elles qui font exister, évoluer un mode de vie, mais aussi, in fine, une civilisation. Or l’histoire occidentale de ces cinquante dernières années est celle d’un modèle qui a évincé cette majorité ordinaire qui avait contribué à construire la civilisation occidentale. La principale cause de ce qu’on appelle « l’effondrement ou la fin de l’occident » n’est pas l’émergence du « Sud global », l’islam ou le wokisme, il n’est même pas prioritairement l’effondrement des naissances (qui est un phénomène mondial à l’exception de l’Afrique sahélienne), non, il est d’abord la conséquence du choix des élites occidentales entamé au siècle dernier. Celui d’avoir exclu ceux qui font la sève de la société, ceux qui font vivre et perdurer une culture : les gens ordinaires. Le mouvement tellurique de la majorité ordinaire est celui de catégories qui n’entendent plus rester hors jeu mais souhaitent au contraire faire perdurer une civilisation qu’ils ont contribué à construire.— Pour en revenir à votre livre, pourquoi avoir choisi cette forme très éloignée de vos précédents essais ? Après avoir maintes fois tenté de décrire la réalité sans être entendu par les « élites », est-ce une forme de pied de nez ?
— Une fable métaphysique pour décrire le grand schisme d’occident, cela s’imposait, non? Cette forme part aussi d’un constat : je pense que le dôme de chiffres et de données dont nous sommes abreuvés ne nous permet plus de voir l’essentiel, c’est-à-dire le développement de deux expériences humaines parfaitement antinomiques et qui nous conduisent vers l’abîme. Quant aux élites et couches supérieures, vous vous trompez, elles ont parfaitement compris et entendu. Mais elles n’entendent pas bouger pour deux raisons. La première est un manque d’intérêt pour le bien commun et un manque de courage. La deuxième, et c’est un point essentiel : les élites et catégories supérieures ne jouent pas leur peau dans le modèle qu’elles ont promu, au contraire, elles en bénéficient un peu ou beaucoup. Dans ce contexte, et à un moment où l’individualisme et l’égotisme imprègnent de plus en plus ce monde d’en haut, il y a peu de chance pour qu’elles reconnaissent un jour qu’elles se sont trompées. Elles n’évolueront que sous la contrainte. Nous vivons un moment qui n’est pas « social » ou « économique » mais un moment existentiel qui n’est évidemment pas réductible à des tableaux statistiques ou à des cartes. La question fondamentale est celle des lisières, du mystère de la civilisation et des valeurs qui portent la société et la culture populaire. Cette transcendance, ce mystère, n’est pas et ne sera jamais un sujet pour le chercheur d’État idéologisé (pléonasme) en sciences sociales.
— C’est aussi un moyen de parler pour la première fois de vous, et surtout des vôtres. Tout votre travail de géographe a-t-il été finalement guidé par votre enfance dans un milieu populaire ?
— Il s’agit moins de parler de moi que de l’expérience que beaucoup de personnes ont vécue, ressentie. Il s’agit de mettre en scène « l’universel » d’une expérience et d’un ressenti qui sont celui de la majorité ordinaire en France comme en Occident. Je revendique complètement cette absence de distance avec un sujet qui n’est pas un « sujet », les gens dont je parle ne sont pas inventés, je les connais, je vis avec eux, je mourrai avec eux. Je sais que ces gens ordinaires n’ont pas besoin qu’on pense à leur place, qu’on les définisse. Je ne ferai jamais ça.
— Vous refusez de vous catégoriser comme « pauvre ». L’image véhiculée par la sociologie ou les médias des classes populaires est-elle trop misérabiliste ? Qu’est-ce que cela révèle ?
— Il n’y a évidemment aucune honte à être pauvre, mais le revendiquer, c’est autre chose, c’est accepter la victimisation, c’est pour nous la marque de la soumission. Pour les classes populaires, cette catégorie, « pauvre », et ce qui y était associé, l’aide sociale notamment, n’a jamais été quelque chose que l’on mettait en avant. C’est la petite bourgeoisie de gauche qui a collé cette étiquette, notamment aux habitants de banlieue - en cherchant à les enfermer dans une victimisation éternelle.
— Vous détestez également l’expression « quartiers populaires ». Pourquoi ?
— Cette expression stupide, « quartiers populaires », a été médiatisée au moment où la gauche lâchait la classe ouvrière et la question sociale, il s’agissait alors d’essentialiser les banlieues pour en faire un objet culturel et politique à la main des partis de gauche. Par essence majoritaire, le « populaire » est ainsi devenu un concept « minoritaire ». La majorité des classes populaires ont alors commencé à être invisibilisées, celles qui vivaient dans la France périphérique, celle des petites villes, des villes moyennes, des zones rurales. C’est ainsi, grâce à la gauche, que le «populaire» est devenu un petit segment marketing, un panel de la société, au plus grand bénéfice du capitalisme. (Rires.)
— Vous expliquez également que, dans votre quartier, il n’y avait aucune « mixité sociale » et que ce n’était pas un problème…
— Je rappelle dans le livre que les quartiers populaires n’ont jamais été mixtes socialement et que cela ne posait aucun problème, ni aux gens ni au Parti communiste de l’époque, puisque les catégories populaires étaient intégrées économiquement et culturellement. Cette expression ridicule a été popularisée par la gauche au début des années 1980, au moment où elle allait abandonner la question sociale pour le sociétal en adoptant le modèle globalisé.
— « Sans en avoir conscience, nous faisions vivre une sorte de “socialisme îlien”, en appliquant au quotidien des préceptes chrétiens et communistes fondés sur la valorisation du bien commun et le respect des autres », écrivez-vous. Cela pourrait être la définition même de la décence commune…
— Vous remarquerez que cette idée orwellienne d’un sens moral inné des classes populaires, qui les préserve de l’« égoïsme libéral », rend toujours fous le monde d’en haut et son intelligentsia. Comme si parler de morale, de transcendance, de bien commun, de joie était interdit. Ce constat est d’ailleurs le point de rupture originel entre Métropolia et Périphéria, celui aussi qui mènera Métropolia à sa perte. Il explique en profondeur le mouvement de contestation existentiel initié par la majorité ordinaire. Dépossédés de ce qu’ils ont et de ce qu’ils sont, les gens ordinaires, contre toute attente, ont su préserver un bien unique, dont est parfaitement dépourvu le monde d’en haut : la décence commune. La permanence, au cœur de Périphéria, de ce précieux capital social et culturel, constitue le môle existentiel sur lequel bute le projet eschatologique du monde individualiste et sans limites que nous impose Métropolia. À l’inverse, la société populaire est celle des limites, des contraintes sociales et culturelles, celle du monde « des hommes qui s’empêchent ». Dans une période marquée par «l’extension du domaine du capitalisme», cette morale commune ne peut être tolérée par les tenants d’un ordre économique et sociétal sans limites. Il existe une métaphysique ordinaire, quotidienne, qui protège l’humanité depuis des temps immémoriaux, se manifeste à travers des pratiques, des valeurs et des croyances populaires. C’est cette transcendance du quotidien - dont semblent dépourvues les âmes mortes qui nous gouvernent – qui sauvera la civilisation.
Extrait de: Source et auteur

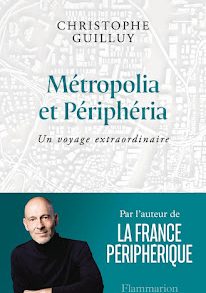



Et vous, qu'en pensez vous ?